L’entretien du mois: Anne Oppliger
La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la Faculté. Aujourd’hui, Anne Oppliger, privat-docent et maître d’enseignement et de recherche clinique (MERclin), rattachée à l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST), et spécialiste des risques biologiques sur le lieu de travail.
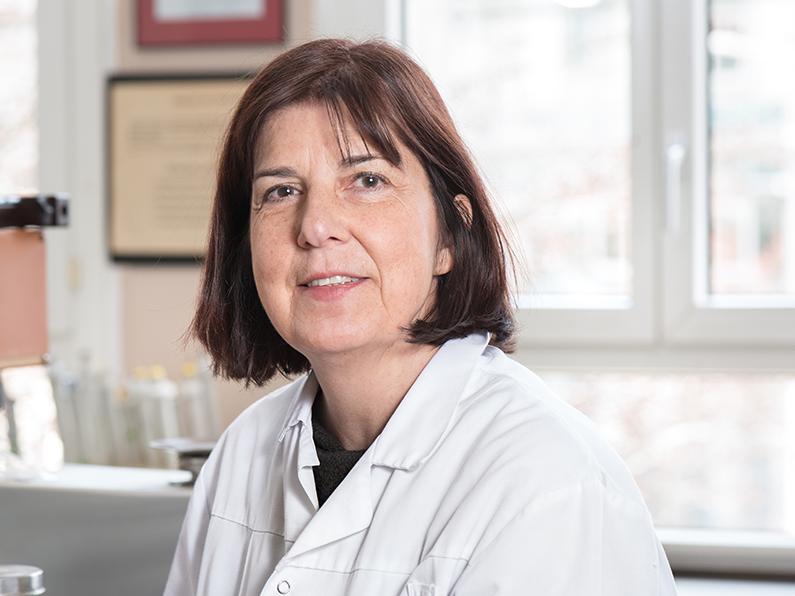
Anne Oppliger, pouvez-vous résumer votre parcours?
J’ai débuté par un apprentissage de laborantine, qui m’a conduit au Service vétérinaire cantonal. Là, j’ai commencé à m’intéresser à la parasitologie. J’ai alors effectué une formation à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, axée sur la médecine vétérinaire. A mon retour en Suisse, j’ai fait le Gymnase du soir, puis la biologie. J’ai enchaîné avec une thèse, qui portait sur les interactions hôte-parasite chez la mésange charbonnière, suivie de deux post-docs. J’ai d’ailleurs obtenu un subside Marie Heim-Vögtlin du FNS, qui était un outil de soutien aux carrières féminines – j’ai eu deux enfants dans l’intervalle. Enfin, je suis arrivée à l’IST en 2001, comme spécialiste des risques biologiques. J’avais envie de faire un peu moins de fondamental, un peu plus d’appliqué.
Les risques biologiques, de quoi s’agit-il?
Cela comprend les champignons, les bactéries, mais aussi les endotoxines, des toxines faisant partie de la membrane de certaines bactéries, et qui peuvent entraîner une réponse inflammatoire. Il faut bien comprendre que je travaille principalement sur les bactéries environnementales non infectieuses. Ce qui nous importe à l’IST, ce n’est pas une bactérie spécifique, responsable d’une maladie, auquel cas ce sont les médecins, le Service des maladies infectieuses qui prend le relais; nous nous focalisons sur la charge totale de microorganismes en suspension dans l’air, qui peut se traduire en allergies, en irritation, etc. Pour prendre quelques exemples, nous avons effectué des études dans des stations d’épuration, des scieries ou des animaleries de rongeurs.
Quels sont vos projets de recherche en cours?
Depuis huit ans, je me suis plutôt concentrée sur l’antibiorésistance dans les élevages d’animaux, et sur la transmission de bactéries résistantes aux antibiotiques de l’animal à l’homme. J’ai deux projets en démarrage: le premier, doté d’un subside «Joint Southeast Asia» du FNS, est une collaboration suisso-franco-thaïlandaise. Le second s’insère dans le PNR 72 du FNS, qui a comme thème la «résistance aux antimicrobiens». Dans ce second projet, nous allons nous focaliser sur le «résistome», c’est-à-dire tous les gènes de résistance présents dans les matières fécales. C’est en quelque sorte la suite d’un projet qui arrive à terme, réalisé avec l’Institut des maladies infectieuses de Berne. Dans ce cadre, nous avons étudié l’impact qu’un travail au contact des porcs avait sur le microbiote nasal des éleveurs. A noter que nous avons été les premiers en Suisse à utiliser une approche dite «One Health», c’est-à-dire à intégrer animaux, hommes et environnement dans le même tableau. Cela peut sembler évident, mais jusqu’ici, quand on récoltait des données sur l’antibiorésistance chez les porcs, par exemple, on ne regardait pas ce qu’il se passait chez les éleveurs.
Qu’avez-vous observé dans cette étude?
En premier lieu, nous avons constaté que la prévalence de l’antibiorésistance augmente fortement chez les éleveurs de porcs. Les MRSA, les staphylocoques dorés résistants à la méticilline, ne sont présents que chez 2-3% des gens, dans la population générale. Cela culmine à 13% chez les éleveurs! Ce n’est pas dangereux en soi pour les éleveurs en bonne santé, mais avec ces porteurs de bactéries résistantes se pose la question de la dissémination dans l’environnement. Car des gènes de bactéries non pathogènes peuvent être transmis à d’autres bactéries. Deuxièmement, nous nous sommes aussi intéressés, au-delà de l’antibiorésistance, aux communautés bactériennes nasales de ces travailleurs. Nous avons constaté qu’on trouvait chez les éleveurs une diversité bactérienne beaucoup plus élevée que dans la population générale, et qu’il s’agissait d’un microbiote spécifique à la ferme, voire même à une ferme en particulier. Il ne faut pas y voir forcément un risque, cela pourrait même être bénéfique, puisqu’on suppose que la perte de la diversité bactérienne pourrait être un problème pour le système immunitaire. On sait que, tendanciellement, les enfants élevés dans les fermes souffrent moins d’allergies.
Une consolation, pour une profession très exposée aux risques biologiques?
On peut le voir comme cela. L’agriculture est en effet particulièrement exposée à toutes sortes de nuisances. A cause de l’élevage mais aussi des moissons. Celles-ci soulèvent des nuages d’endotoxines et de champignons microscopiques. Et les agriculteurs cumulent: outre les risques biologiques liés aux animaux et aux céréales, il y a les risques chimiques liés aux pesticides et les accidents liés aux machines et véhicules agricoles… Mais tous les professionnels qui manipulent de la matière organique, qu’ils travaillent dans l’agroalimentaire ou le traitement des déchets, sont fortement exposés, en raison notamment de la présence de bioaérosols, de microorganismes dans l’air. A cet égard, je fais partie d’un comité d’experts de l’ANSES[1], à Paris, sur les risques pour les travailleurs du secteur des déchets.
En dehors de la recherche, vous travaillez aussi beaucoup sur mandat d’entreprises…
C’est une partie de mon travail, en effet. Je précise que c’est consultatif, ce n’est pas de l’inspectorat. Il s’agit d’identifier des risques, et de proposer des solutions. Je collabore aussi avec le Service de pneumologie du CHUV et de la PMU: on me demande par exemple de chercher, au domicile du patient, une cause environnementale pour une pathologie spécifique des voies respiratoires. Il peut s’agir de moisissures ou de certains produits d’entretien. L’un dans l’autre, je suis beaucoup sur le terrain.
[1] L’Agence nationale – française- de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.