L’entretien du mois: Marc-Antoine Bornet
La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la Faculté. Aujourd’hui, Marc-Antoine Bornet, médecin assistant au Service de médecine interne du CHUV, doctorant à l’UNIL et lauréat du Prix «Qualité de vie 65+» de la Fondation Leenaards.
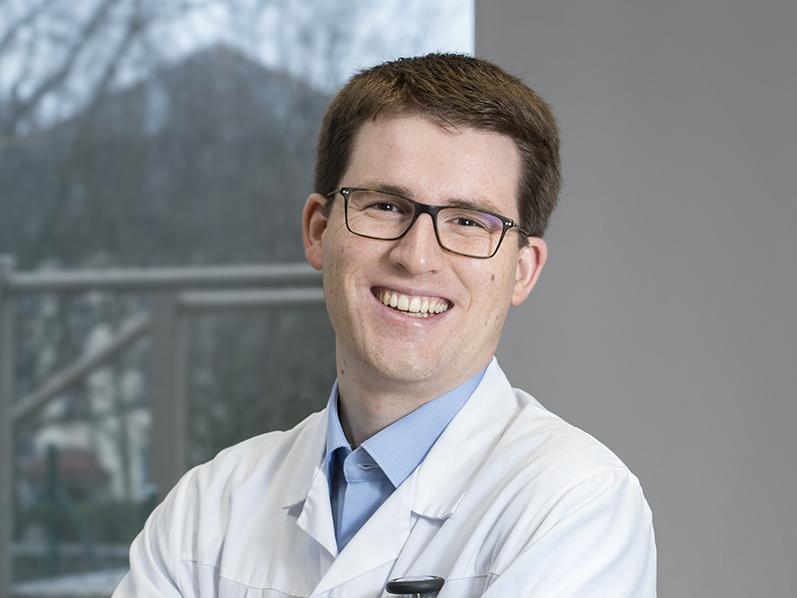
Marc-Antoine Bornet, pouvez-vous résumer votre parcours?
J’ai terminé mes études de médecine en 2015, et j’ai immédiatement enchaîné avec un MD, sous la supervision de la Dre Stéphanie Monod (ndlr: qui a pris depuis la direction du Service vaudois de la santé publique). J’ai réalisé ce travail au CUTR Sylvana, le centre de réadaptation gériatrique du CHUV, où je me suis intéressé à la qualité de vie des patients âgés. Auparavant, pour mon travail de Master, je m’étais penché sur la question – complexe - de la spiritualité. Après la gériatrie, je suis parti en médecine interne. Avec le soutien de mes supérieurs, j’ai décroché en 2017 le prix «Qualité de vie 65+», qui encourage des projets visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes de plus de 65 ans. Ma recherche en cours se focalise sur le «désir de mort» chez les patients âgés hospitalisés en médecine interne. Tout en menant ces recherches, je travaille en clinique comme médecin assistant.
Qualité de vie, désir de mort, spiritualité: toutes ces questions sont liées?
Elles se recoupent en effet. On peut dire qu’une personne est constituée de quatre dimensions: biologique, psychologique, sociale et spirituelle. Ces quatre dimensions agissent sur la qualité de vie. Comment l’influencer? Il faut d’abord que le patient se sente compris, il faut oser par exemple aborder la détresse spirituelle, la question du sens. Autrement dit, qu’est-ce qui est essentiel pour lui? Qu’est-ce qui le motive à se faire soigner? Du moment qu’un patient se sent compris, entendu, il devient possible de construire le meilleur plan de soins.
Ce qui ne veut pas dire forcément le guérir?
En médecine interne, les patients souffrent de pathologies complexes, souvent chroniques. 70% ont plus de 65 ans. On guérit très peu, au sens strict. Mais on peut améliorer leur qualité de vie. Mon but est d’accompagner le patient avec le meilleur projet thérapeutique possible. La mort n’est pas forcément un échec. Je vois la médecine comme une créature à deux têtes: il y a un côté technique, les actes médicaux, sur lequel on met beaucoup l’accent; mais il y a aussi un côté humain, tout aussi important. Dans la prise en charge, nous devons faire particulièrement attention à ces moments-clés dans l’échange avec le patient. Par exemple quand il nous dit: «Si mon cœur lâche, laissez-moi partir», on ne peut pas se borner à quittancer, il nous faut comprendre pourquoi il dit cela.
Vous avez l’impression qu’il y a un manque à ce niveau-là?
Le vécu face à la mort est traité en pratique clinique, quotidiennement. Mais il nous manque des modèles de prise en charge globale, axés sur la qualité de vie. C’est pourquoi il faut pousser la recherche, systématiser. C’est mon objectif à travers ma recherche sur le désir de mort: quels sont les liens avec la qualité de vie et les déterminants sociaux. L’idée est de procéder à une analyse quantitative d’entretiens. Je ne le cache pas, j’aime tout ce qui est mathématique. Dans ce cas, l’utilisation de questionnaires nous permettra cette analyse quantitative de chaque dimension (biologique, psychologique, sociale et spirituelle). C’est réducteur, j’en suis conscient, et c’est aussi inévitable. Mais si notre méthodologie est solide, cela peut être un guide déterminant pour la prise en charge.
On a souvent une vision romantique du médecin comme «celui qui guérit». On a tendance à oublier que la mort fait partie de votre quotidien…
Je trouve qu’il est important d’aborder ces questions très tôt, déjà comme étudiant. Je prends l’exemple de la dissection: certes, c’est très technique, mais c’est aussi le premier «patient» auquel est confronté l’étudiant en médecine. Et ce «patient» est mort. Aux Etats-Unis, il y a des expériences de «débriefing» où les étudiants doivent dessiner ou rédiger un poème après une dissection. En Allemagne, il existe des cérémonies de remerciement après une dissection, où la famille du défunt est invitée. Je ne pense pas que cela soit dans notre culture. Mais néanmoins, il ne faut pas banaliser cette expérience dès le début. Une dissection, c’est un acte fort; nous n’avons pas affaire à un bout de plastique, mais à un corps, qui était une personne. On ne doit pas être indifférent. La mort, tout médecin va la rencontrer souvent dans sa carrière. La dissection, si on se pose les bonnes questions à ce moment-là, peut être un tremplin pour la suite.
Vous avez par ailleurs fait partie du comité de Doctors and Death Lausanne, un projet de l’Association suisse des étudiants en médecine, et co-écrit un ouvrage (La mort: une inconnue à apprivoiser, éd. Favre, 2013) sur votre expérience d’étudiant et de jeune médecin.
Oui, et je dois souligner le dynamisme de la Faculté à ce sujet. Ces thématiques ont pris un bel essor à la FBM, à travers plusieurs initiatives et personnes, dont par exemple un cours à option «Vivre face à la mort». C’est important: les étudiants doivent apprendre, être en mesure de poser des questions, de verbaliser leur expérience.