L’entretien du mois: Carlo Rivolta
Parce que la FBM, ce ne sont pas que les professeur·e·s ordinaires, nous présentons chaque mois un·e chercheur·euse, issu·e des sciences fondamentales ou cliniques, ou un membre du Personnel administratif et technique (PAT). Sous le feu des projecteurs ce mois, Carlo Rivolta, chercheur au Département de biologie computationnelle (DBC, auparavant Département de génétique médicale), et spécialiste des maladies oculaires.
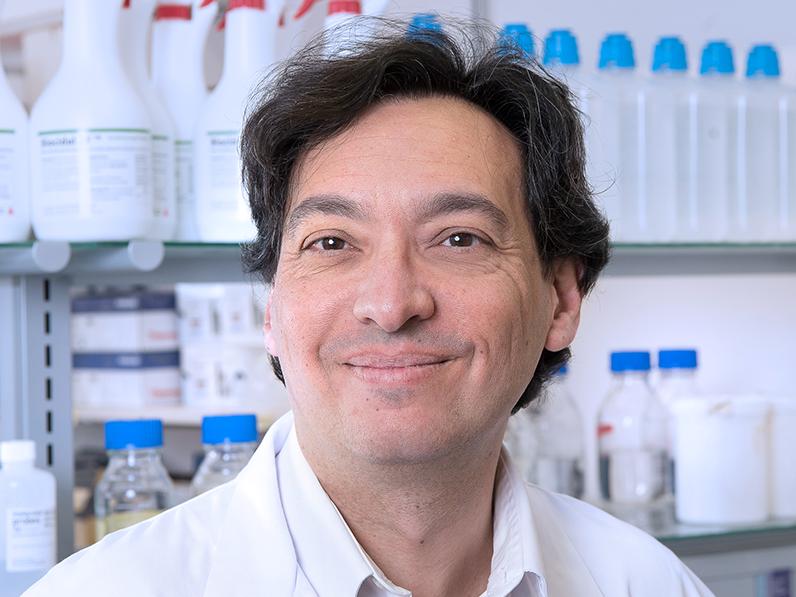
Carlo Rivolta, pouvez-vous nous résumer votre parcours?
J’ai toujours eu un intérêt pour les gènes, pour l’hérédité, mais aussi pour les mathématiques et les ordinateurs. Si on met les deux choses ensemble, on obtient la… génomique. Et aujourd’hui encore, je partage mon temps entre le labo et l’informatique. Je ne me satisfais pas d’une prédiction, j’ai toujours besoin de valider les choses à la paillasse. Niveau formation, j’ai obtenu mon Master à Pavie, université réputée pour son programme de génétique, et je suis arrivé à Lausanne en 1995 pour y faire mon PhD. J’ai travaillé sur les bactéries, qui étaient à l’époque le seul organisme à avoir été séquencé au niveau génomique. En parallèle, j’ai effectué une formation post-grade de bioinformatique à l’EPFL. En 1999, je suis parti pour Harvard, où j’ai rejoint le groupe de Ted Dryja. A ce moment-là, il y avait une explosion des données au niveau génomique qui a abouti, quelques mois plus tard, au premier brouillon de la séquence complète du génome humain. C’était une période extraordinaire, mais après cinq aux Etats-Unis, il me fallait bouger, il me fallait «grandir». L’offre lausannoise était la plus intéressante, et je suis donc revenu en Suisse en 2004.
Pouvoir travailler sur l’Homme, c’était important pour vous?
Quand on travaille sur la génomique des bactéries modèles, il s’agit généralement de recherches très fondamentales. Or je voulais faire quelque chose pour les patients. J’ai aussi eu la chance de vivre de l’intérieur la révolution du Next-Generation Sequencing (NGS), commercialisé autour de 2006: il s’agissait d’une véritable révolution technique, qui a complètement changé la donne. Auparavant, on ne pouvait séquencer que de petits bouts de génome; mais grâce au NGS, on avait tout à coup la possibilité de séquencer un génome entier en quelques jours. J’ai eu la possibilité de développer le NGS à Lausanne. Au départ, cette technique n’était appliquée qu’à des organismes très simples… et je me retrouvais donc à nouveau avec des bactéries. Mais nous avons travaillé avec quelques personnes de l’Institut suisse de bioinformatique pour la transformer en quelque chose d’utilisable pour la médecine.
Vous travaillez surtout sur la rétinite pigmentaire et d’autres dégénérescences héréditaires de la rétine. Une raison derrière ce choix?
La rétine, c’est en quelque sorte l’écran de cinéma sur lequel sont projetées les informations venant de l’avant de l’œil. On ne peut pas corriger le problème par l’optique, par des lunettes. Il y a donc un gros défi en termes cliniques. Il existe déjà des thérapies géniques, consistant à remplacer un gène déficient par un gène sain via un vecteur viral. Des essais cliniques concluants ont déjà eu lieu. C’est aussi un challenge du point de vue de la recherche: dans le cas de l’hérédité mendélienne classique, un seul gène est responsable d’une maladie, comme la mucoviscidose par exemple. Or les maladies de l’œil se caractérisent par une des plus grandes hétérogénéités génétiques connues, puisqu’une centaine de gènes peuvent être impliqués!
Pour corriger un défaut génétique, soit par thérapie génique, soit par d’autres méthodes, encore faut-il pouvoir identifier le ou les gènes responsables. Et c’est là que vous intervenez?
Tout à fait. Et pas seulement pour les maladies oculaires. Concernant la rétine, nous travaillons bien sûr avec l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, mais la plupart de nos patients viennent d’ailleurs: nous recevons des échantillons d’ADN de patients de toute la planète. Je travaille notamment avec des cohortes japonaise, espagnole, américaine et grecque. Nous faisons d’ailleurs partie de l’European Retinal Disease Consortium (ERDC). Bénéficier d’un grand réseau est capital pour la recherche.
Vous avez par exemple été les premiers à décrire une nouvelle maladie rare, associant cécité et surdité, qui a donné lieu à une publication en septembre dans The American Journal of Human Genetics…
En effet. Un ophtalmologue suédois avec lequel nous travaillons nous a signalé un cas particulier, une personne souffrant d’une dystrophie rétinienne, touchant la vision centrale, combinée avec un déficit d’audition. Grâce à notre réseau, nous avons pu trouver un second cas similaire en Crète, et nous avons été en mesure d’identifier le gène responsable de ce nouveau syndrome, encore jamais décrit, ni cliniquement ni au niveau moléculaire. Nous avons eu une autre publication en octobre sur le mélanome de l’uvée: une tumeur rare, avec des taux de survie dus aux métastases qui n’ont guère évolué en 25 ans. Or, nous avons découvert que cette tumeur comporte peu de mutations géniques, en moyenne juste une quinzaine, contrairement au mélanome de la peau qui a tendance à en accumuler plusieurs centaines! C’est une découverte importante, qui ouvre de nouvelles pistes pour le traitement. Et nous avons bénéficié dans ce cas du soutien de Fond’action contre le cancer, une fondation suisse, et de la masse critique de Jules-Gonin, qui est un centre de référence, en Europe et dans le monde, pour le traitement des tumeurs intraoculaires.
par Nicolas Berlie - Communication FBM